Pourquoi diable un billet sur la fantasy francophone ?
En fait, je me suis lancé, car je n’ai pas vraiment trouvé d’articles s’y consacrant. Le sujet ne doit pas passionner les foules…
Il faut dire que, située en bas de la hiérarchie des genres littéraires, la fantasy occupe rarement une place de choix dans les gazettes, littéraires ou non. Bon d’accord, l’appellation « fantasy », d’emblée ça ne fait pas très sérieux. Seul un événement important – un succès mondial, relayé par un film ou une série – incite les journaux à s’abaisser à parler d’une œuvre de fantasy. Dans ce cas, ce qui agite la sphère médiatique est plus le phénomène de société que l’œuvre littéraire en elle-même. Et encore, je vous parle là de succès écrits dans la langue de Shakespeare ! Car pour la presse, la fantasy écrite dans la langue de Molière ne semble pas exister. Sauf lorsque, par exemple, un auteur connu (qui vient de la littérature blanche) ose commettre une œuvre de fantasy – cas de Muriel Barbery, l’auteur du best-seller L’élégance du hérisson.
La science-fiction de langue française est nettement mieux lotie – avec des auteurs comme Bernard Werber ou Alain Damasio, qui jouissent d’une aura médiatique et permettent de rendre compte de l’existence d’une littérature de l’imaginaire francophone bien vivace !
Maintenue dans une certaine marginalité, la fantasy francophone s’est néanmoins développée, à l’ombre des grands auteurs britanniques et américains.
Lorsque j’ai commencé à lire de la fantasy (à une époque que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître), j’ai dévoré à peu près tout ce que possédait la bibliothèque de la ville. Soit quasi-exclusivement des œuvres anglo-saxonnes. Puis m’est apparu un jour Mathieu Gaborit. La fantasy de langue française existait donc !
J’ai voulu ici, à travers mon expérience de lecteur et à l’aide d’informations glanées de-ci de-là, parler des œuvres et des auteurs qui ont jalonné les débuts de la fantasy francophone (période 90-2000) en essayant de dégager leur spécificité, notamment par rapport aux maîtres anglo-saxons.
Bonne lecture !
La fantasy, genre littéraire caractérisé par un monde fictionnel empreint de surnaturel magique (ou merveilleux), est a priori née au Royaume-Uni dans la seconde moitié du XIXème siècle, avec la publication d’œuvres telles que La princesse et le gobelin (en 1872) de l’auteur écossais George MacDonald, ou La plaine étincelante (en 1891) de l’auteur et peintre britannique William Morris.
J.R.R Tolkien (qui a reconnu l’influence de William Morris) peut être considéré comme l’auteur lui ayant donné ses lettres de noblesse et une aura sans précédent – le Seigneur des anneaux, œuvre écrite dans l’entre-deux guerre et publiée à titre posthume en 1954-1957, en est l’ouvrage incontournable de référence, formant l’archétype du roman médiéval-fantastique.
À ses côtés, les œuvres de Robert E Howard (inventeur de l’heroïc-fantasy avec la publication de Conan le Barbare en 1930), de Mickael Moorcok (la saga d’Elric le melnibonéen, parue en 1961), et de Fritz Lieber (le cycle des épées, édité à partir de 1970), ont forgé et canonisé les codes du genre.
La publication en fantasy est massivement anglo-saxonne. Les succès également, comme en témoigne celui, plus récent et international (notamment grâce à la série), de Game of thrones, de l’auteur américain G.R.R Martins.
Est-ce à dire que les plumes francophones ont jeté l’éponge ? Que les lecteurs boudent les publications de fantasy francophones ? Loin de là !
Je vais tenter ici, non pas de rendre compte de manière exhaustive des publications de fantasy francophones, mais de dégager, à travers quelques exemples marquants, ce qui pourrait en constituer la spécificité.
Naissance et envol : 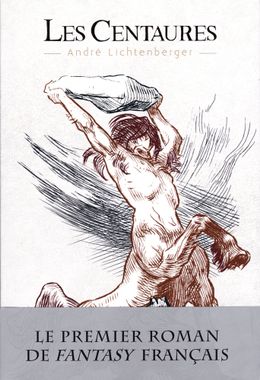
Si une des premières œuvres de fantasy francophone, Les centaures, d’André Lichtenberg, date de 1904, il faut attendre la fin du XXème siècle pour qu’un véritable corpus de romans propres à ce genre se constitue.
En effet, contrairement à la science-fiction, l’engouement pour la fantasy est plus tardif dans la sphère francophone, où le genre commence à être plébiscité à partir des années 80 – notamment avec l’apparition des jeux de rôle tel que le fameux Donjon et dragons.
Des auteurs vont s’y engouffrer et des éditeurs spécialisés apparaître dès la décennie suivante, lui conférant ainsi une identité propre.
Côté auteurs français, citons parmi les plus emblématiques :Pierre Bordage (Rohel le conquérant – 1992, œuvre qui mélange science-fiction et éléments de fantasy), Mathieu Gaborit (Les chroniques crépusculaires – 1995, Abymes – 1996), Sabrina Calvo (Delius, une chanson d’été-1997), Pierre Grimbert (Le cycle de Ji – 1997), Laurent Kloetzer (Mémoire vagabonde – 1997), Fabrice Colin (Vestiges d’Arcadia – 1998), Léa Silhol (La sève et le givre, 2002), Michel Robert (L’ange du Chaos – 2004, 1er tome de la série L’agent des ombres), Pierre Pevel (Les lames du cardinal-2007), Jean-Philippe Jaworski (Gagner la guerre – 2009), Lionel Davoust (La volonté du dragon – 2009).
Côté éditeurs, les maisons spécialisées voient le jour – Mnemos en 1996, Bragelonne en 2000, Les moutons électriques et ActuSF en 2003.
La fantasy française prend son envol durant les années 90-2000.
À noter qu’il en est de même pour la fantasy québécoise.
En effet, celle-ci prend naissance au milieu des années 80 avec le roman Ludovic, de Daniel Sernine, publié en 1985. Il sera suivi en 1990 de L’héritage de Quader, de Philippe Gauthier et de La requête de Banad, de Joël Champetier.
Si les débuts sont balbutiants, la décennie 90 est marquée par l’apparition d’auteurs spécialisés propulsés par les éditons Mediaspaul (et sa collection jeunesse).
Des auteurs tels que Yves Ménard et son œuvre Le mage des fourmis (1995), Julie Martel (La quête de la Crystale) ou Jean-Louis Trudel (Les îles du Zodiaque) donnent ainsi de l’épaisseur au genre.
Ces auteurs préparent la déferlante des années 2000, sous l’égide des éditions Les Intouchables, qui publient notamment à partir de 2003 la série des aventures d’Amos Daragon, de Bryan Perro, série qui bénéficie d’un grand succès populaire.
Singularité : 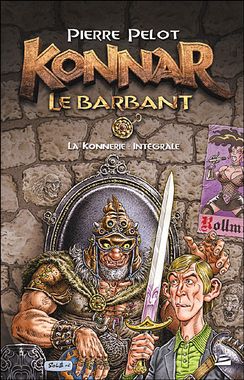
Si les œuvres de Tolkien, de Fritz Lieber, de Michael Moorcock et de Robert E Howard ont marqué de leur empreinte la fantasy, les auteurs francophones ont eu tendance à s’en démarquer, sans pour autant renier leur influence.
La prédominance de la science-fiction dans la littérature de l’imaginaire francophone, le relatif mépris dans lequel la fantasy était tenue, la constitution de stéréotypes dans lesquels le genre tendait à s’enfermer (et facilement parodiés, à l’instar de Pierre Pelot et son Konnar le barbant, dont le titre en lui-même – clin d’œil à l’œuvre de Robert E. Howard– annonce la charge parodique), et la réception tardive du genre dans la sphère francophone ont certainement contribué à cette démarcation.
C’est peut-être dans la mise à distance des canons littéraires de la fantasy anglo-saxonne que les plumes francophones ont pu proposer des œuvres originales, sans pour autant sacrifier les « propriétés » du genre.
À côté de la veine parodique d’un Pierre Pelot, d’une Catherine Dufour (Quand les dieux buvaient, Blanche neige et les lance-missiles) ou de Pierre-Luc Lafrance (Y a-t-il un héros dans la salle), les œuvres (moins « critiques ») citées plus haut rendent compte de la spécificité de la fantasy francophone.
À partir de Mathieu Gaborit. 
C’est, il me semble (ceci n’engage que mon expérience de lecteur), avec Mathieu Gaborit et ses Chroniques des crépusculaires que la fantasy francophone se démarque, par son univers et son écriture.
Dans un style non dépourvu d’élégance, l’auteur dépeint un univers sombre et mélancolique, où la souffrance et l’altérité forgent le destin d’un jeune homme, Agone de Rocheronde.
On est loin des grands espaces et du souffle épique d’un Tolkien. Ce n’est pas non plus l’univers froid et fataliste d’un Moorcock, ni celui, violent et nihiliste, d’un Robert E. Howard.
La magie – élément incontournable des œuvres de fantasy – est présente à travers trois « sources » : l’Accord (c’est-à-dire la musique), les Danseurs (petits êtres aux corps asexués et androgynes), un artefact (objet enchanté telle Pénombre, l’épée d’Agone).
La complexité du système de magie est un des éléments originaux de cette œuvre de fantasy – on peut certainement y voir ici l’influence des jeux de rôle, l’auteur ayant participé à un magazine de jeux de rôle et ayant été concepteur de jeux.
La magie en elle-même n’appartient pas aux hommes (à l’inverse d’un Gandalf, archétype du magicien accompli, qui par des formules et des gestes produit directement de la magie). Elle est extérieure à eux, à leur corps. C’est le corps des Danseurs qu’il s’agit de maîtriser, d’influencer, par la douceur (l’empathie) ou la force (qui peut aller jusqu’à la torture). C’est l’instrument de musique (cistre, clavecin) qu’il s’agit de maîtriser pour produire de la magie. Enfin, il s’agit également d’être en symbiose avec son épée (objet symbolisant la puissance, à l’instar de l’épée d’Elric dans l’œuvre de Moorcock – la différence réside ici dans le rapport entre l’épée et son propriétaire : Agone commande son épée enchantée alors qu’Elric lui reste soumis) afin de la laisser « prendre les devants » lors des combats.
Maîtriser la magie revient donc avant tout à maîtriser ce qui est vecteur de magie : les Danseurs, la rapière, l’instrument de musique. Le rapport entre la magie et l’art (la danse, la musique) transparaît ici : c’est par l’art que les êtres humains accèdent à la magie. Les autres espèces, êtres faisant traditionnellement partie de l’univers du conte, du récit merveilleux tels que les lutins, les fées, les nains, possèdent leur propre magie (c’est la fée Amertine qui donne « vie » à la rapière Pénombre).
Une fantasy plus citadine ?
Le rapport au lieu est peut-être également un autre élément singulier de cette fantasy.
Dans l’œuvre de Mathieu Gaborit, l’action se déroule pour les deux tiers du récit non pas sur de grands espaces ou lieux de nature (grandes plaines, forêts immenses, etc) mais dans des lieux plus confinés (le collège Souffre-jour, la ville de Lorgol – le plus souvent ses bas-fonds).
La délimitation de cet espace permet de déployer une prose axée sur l’ambiance, l’atmosphère des lieux et leur influence sur les personnages. Personnage lui-même, le lieu façonne les êtres qui y vivent, souvent de manière douloureuse, dont ils ne peuvent s’abstraire – sauf à le détruire.
Ce « personnage » emblématique se retrouve dans le roman suivant le cycle des crépusculaires, à savoir Abyme (le nom permet de personnifier le lieu et connote également le rapport avec les êtres qui vivent). C’est ici la ville labyrinthique, tentaculaire, la toile d’araignée dans laquelle on se perd et s’englue, mais qui peut aussi vous dissimuler, vous sauver.
Ce rapport à la ville apparaît dans d’autres œuvres de fantasy comme Le Paris des merveilles de Pierre Pevel, qui prend pour cadre le Paris de la belle époque (un Paris revisité où se côtoient monde réel et monde merveilleux),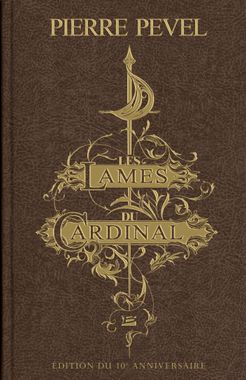 ou Vestiges d’Arcadia de Fabrice Colin, dont l’histoire se situe à Londres au XIXème siècle ou encore Gagner la guerre, de Jean-Philippe Jaworski, dont le cœur de l’intrigue se trouve à Ciudalia (ville imaginaire qui serait le pendant de Florence dans l’Italie de la Renaissance), lieu de pouvoir et capitale de la République.
ou Vestiges d’Arcadia de Fabrice Colin, dont l’histoire se situe à Londres au XIXème siècle ou encore Gagner la guerre, de Jean-Philippe Jaworski, dont le cœur de l’intrigue se trouve à Ciudalia (ville imaginaire qui serait le pendant de Florence dans l’Italie de la Renaissance), lieu de pouvoir et capitale de la République.
Bien sûr, cette fantasy plus citadine (qui n’est pas de l’urban fantasy, genre qui prend pour cadre le monde contemporain) n’est pas représentative de la totalité de la fantasy francophone mais me semble suffisamment marquante et récurrente pour être soulignée.
Une fantasy moins manichéenne ?
Un autre trait saillant est sans doute le rapport à « l’ombre ».
En effet, dans les Chroniques crépusculaires, l’ombre, plus que la lumière, domine le roman. Que ce soient les lieux (à Souffre-jour, l’arbre ronge la lumière, maintenant le collège dans une atmosphère sombre ; dans Lorgol, l’action se déroule la nuit ou dans les bas-fonds), les personnages (le principal de Souffre-jour se nomme Diurne, Agone, héros au passé ombrageux, subit un sort qui lui rend la lumière du jour insupportable, Amertine est une fée noire, le mage qui aide Agone à combattre les janréniens appartient à l’ordre des Obscurantistes).
On peut y voir un certain rejet du manichéisme (Bien /Mal -Lumière/Ombre), Agone n’étant pas vraiment un héros « solaire » : son passé, sombre et violent, constitue sa part d’ombre. Pas de combat du Bien contre le Mal mais pour une conception de la magie.
Pour les mages Obscurantistes janréniens, la magie doit dominer le monde- les mages doivent donc s’emparer du pouvoir temporel ; pour Lershwin, le fardadet, la magie doit appartenir à tout le monde ; pour les Eclipsistes, la magie doit rester en dehors du pouvoir temporel et n’être réservée qu’à une élite à même de savoir l’utiliser – conception aristocratique que partage Agone.
Le même refus du manichéisme est présent dans Gagner la guerre : le personnage principal et narrateur don Benvenuto est un anti-héros, un assassin gouailleur et sans illusion. Le combat qui sous-tend le récit est un combat pour la quête et la préservation du pouvoir – qui se joue dans les méandres du jeu politique. Pas de force maléfique menaçant de détruire le monde, mais des rapports de force, des conflits, des calculs machiavéliques pour s’imposer. 
Dans L’ange du Chaos, L’Empire de la lumière, le Chaos et les Ténèbres se livrent une guerre sans merci. Cette structure pourrait donner lieu à un récit manichéen, mais il n’en ait rien. Michel Robert dépeint un univers sombre, violent et cruel, au sein duquel le « héros », Cellendhyl de Corvatar, ancien agent de la Lumière trahi par les siens, se met au service du Chaos et cherche à assouvir sa vengeance. Dans cet univers fait d’intrigues et de soif de domination – dont la teinte sombre n’est pas sans rappeler celui d’un Moorcok – on tue de sang-froid, sans culpabilité ni repentir. 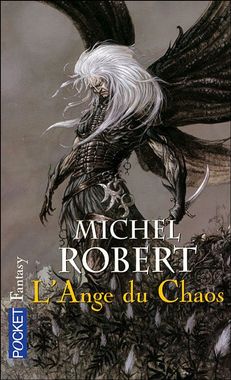
L’œuvre de Lionel Davoust, La volonté du dragon, met en scène le combat entre deux pays imaginaires. L’un est puissant empire dominateur, hégémonique, ayant asservi la magie grâce à la technologie, et l’autre est un petit territoire régi par un culte passéiste. Là encore, pas de lutte du Bien contre le Mal dans ce livre, mais un affrontement – physique et verbal – entre deux conceptions du monde (progrès technologique et rationalité versus foi et spiritualité). Orgueil et préjugés sont mis à mal dans cette bataille à l’issue incertaine. 
Une fantasy plus historique ?
Si la fantasy historique (qui prend pour toile de fond un cadre historique réel et précis) ne constitue évidemment pas une exclusivité francophone (citons seulement Le Lion de Macédoine de l’auteur britannique David Gemmel, œuvre publiée en 1990 et qui se passe dans la Grèce antique d’Alexandre le Grand), celle-ci est bien présente chez les auteurs francophones dominants.
Si dans Gagner la guerre, l’aspect historique tient surtout par une ressemblance troublante avec l’Italie de la Renaissance, l’œuvre de Pierre Pevel Les lames du cardinal prend explicitement pour cadre la France du XVIIème siècle sous le règne de Louis XIII.
À l’instar de David Gemmel, l’auteur mêle dans ce roman de cape et d’épée personnage historique (tel le Cardinal de Richelieu) et éléments propres à la fantasy (dragons, magie). La spécificité tient peut-être ici à l’intertextualité : le roman appelle en référence ceux d’Alexandre Dumas (Les Trois mousquetaires, notamment).
Cet hommage implicite à la figure tutélaire du grand romancier populaire permet d’inscrire la fantasy dans une tradition et de la rattacher à un héritage : celui du roman d’aventure, picaresque, historique, de cape et d’épée, bref celui hybride par essence du roman populaire. Et de rappeler ainsi que le genre fantasy a toute sa place dans la littérature francophone.
À propos de roman de cape et d’épée, on peut également citer le livre de Laurent Kloetzer, Mémoire Vagabonde, roman s’inspirant du XVIIIème siècle libertin et faisant la part belle aux duels.
À noter un attrait pour le Londres du XIXème siècle (époque victorienne), avec les romans de Sabrina Calvo (Delius, une chanson d’été) et de Fabrice Colin (Vestiges d’Arcadia).
Dans ces deux romans, les personnages historiques mis en scène sont à dominante littéraire et artistique. 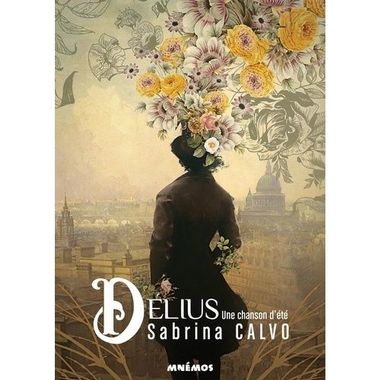
Tandis que Sabrina Calvo s’amuse ainsi, par exemple, à faire intervenir Conan Doyle (sollicité par les protagonistes de l’histoire espérant s’adjoindre les services de Sherlock Holmes pour leur enquête policière – ce qui, évidemment, fait beaucoup rire l’auteur britannique) dans son récit, Fabrice Colin, lui, campe (entre autre) les personnages de William Morris (clin d’œil – hommage à un des pères fondateurs de la fantasy, même si ici le personnage est présenté en tant que peintre, Fabrice Colin mettant soigneusement de côté la casquette de romancier de l’artiste et auteur britannique) et de Dante Gabriel Rossetti, poète et peintre anglais, fondateur du préraphaélisme.
Une fantasy plus « littéraire » ?
Lorsqu’on parle de fantasy, il est rare de s’attarder sur le style de l’auteur – ou, simplement, de l’évoquer. Genre populaire, souvent qualifié de paralittérature, la fantasy est maintenue à distance des enjeux stylistiques propres au champ littéraire.
Pourtant, c’est bien souvent le style de l’auteur qui permet au lecteur d’entrer dans son univers, de s’en imprégner, de faire cette expérience intime et unique, le temps d’une lecture.
La voix narrative, le choix des termes, leur enchaînement, la structure, la progression, le rythme, etc, reflètent le style de l’auteur. Je serais tenté de dire de ce fait – et d’ailleurs je le dis – que chaque auteur a un style (plus ou moins élaboré, plus ou moins remarquable), en fantasy comme dans les autres genres.
Avant de lire Les chroniques des crépusculaires, j’avais lu essentiellement (pour ne pas dire exclusivement) de la fantasy anglo-saxonne. Je me souviens avoir été agréablement surpris par le style de Mathieu Gaborit, qui dénotait un peu par rapport aux œuvres anglo-saxonnes.
Un ton qui cherchait à être juste, élégant, pour dépeindre un univers sombre et mélancolique. Quelques années après, c’est le souvenir du style, de l’atmosphère qui m’est resté, plus que de l’histoire – contrairement, peut-être, aux œuvres anglo-saxonnes.
Dans Gagner la guerre, la gouaille du personnage-narrateur donne une couleur singulière au récit. Tous les registres de la langue (bas, argot, soutenu) sont utilisés par le narrateur dans une prose généreuse et bariolée. C’est cette voix narrative prolixe qui nous tient (ou peut nous rebuter), peut-être plus que l’intrigue (même si celle-ci est très bien construite et menée).
On peut aussi évoquer Mémoire Vagabonde, roman qui se caractérise par le questionnement identitaire d’un écrivain dandy, libertin et désabusé, Jaël de Kherdan. La singularité du roman tient à la structure du récit, étirée et éclatée par la mise en abyme de l’écriture : Jaël met en scène son personnage d’écrivain, enchâssant un récit dans le récit.
roman qui se caractérise par le questionnement identitaire d’un écrivain dandy, libertin et désabusé, Jaël de Kherdan. La singularité du roman tient à la structure du récit, étirée et éclatée par la mise en abyme de l’écriture : Jaël met en scène son personnage d’écrivain, enchâssant un récit dans le récit.
Amnésique, Jaël tente de savoir s’il a ou non commis un crime et reconstitue son passé par la lecture de ses propres écrits – ce qui l’amène à questionner son identité. La confusion du personnage se reflète dans l’éclatement du récit, obligeant le lecteur à suivre différentes temporalités entremêlées (celle du souvenir, de l’écriture, de l’histoire) et l’invitant peut-être à se perdre.
Si le cadre spatio-temporel sous-jacent est celui du XVIIIème siècle libertin, le romantisme est néanmoins présent (notamment à travers le thème de la dualité, de la figure du double), jetant un pont avec le XIXème. L’emprunt de la chanson du groupe de rock Noir Désir Joey dans le roman étire également la temporalité du récit en réfutant la possibilité d’un cadre historique fixe et déterminé – l’auteur assume ainsi le caractère anhistorique des récits du genre fantasy, leur « ouverture temporelle ».
Ouverture temporelle que l’on retrouve également dans Vestiges d’Arcadia, de Fabrice Colin. Si le cœur de l’histoire se trouve à Londres, au XIXème siècle, une partie du récit se déroule à Paris (un Paris futur, post-apocalyptique, suggéré plus que décrit). 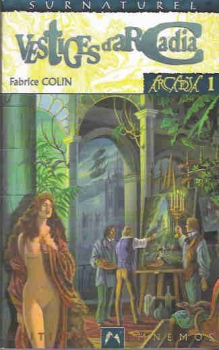
L’auteur procède ainsi à quelques allers-retours entre les deux époques, à laquelle une troisième, plus mythique, vient s’ajouter : celle de la légende arthurienne. La narration, remarquablement ciselée, et la construction maîtrisée du récit nous plongent aisément dans les différentes époques, à travers les affres des personnages.
Enfin, on ne peut évidemment pas parler de style en fantasy sans évoquer l’œuvre de Léa Silhol, La Sève et le Givre. 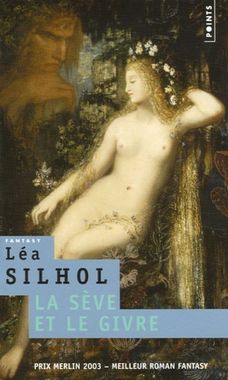 Il s’agit sans doute de l’œuvre de fantasy la plus poétique (et la plus belle d’un point de vue de la langue) qu’il m’ait été donné de lire. À chaque phrase, la poésie éclate et magnifie le récit – inspiré ici de la mythologie irlandaise.
Il s’agit sans doute de l’œuvre de fantasy la plus poétique (et la plus belle d’un point de vue de la langue) qu’il m’ait été donné de lire. À chaque phrase, la poésie éclate et magnifie le récit – inspiré ici de la mythologie irlandaise.
Le travail stylistique de Léa Silhol tire le roman vers la chanson de geste et place la fantasy dans ce qui me semble être l’essence même de la littérature, à savoir : les mythes et la poésie.
Conclusion :
Voilà des pistes de réflexion à travers quelques exemples sur une possible spécificité de la fantasy francophone, laquelle dispose de qualités indéniables pour exister et s’imposer aux côtés des œuvres anglo-saxonnes.
Elles n’épuisent bien évidemment pas la diversité du genre, et les nombreux courants (sous-genres) qui se sont développés en fantasy depuis une vingtaine d’années (on peut penser notamment à la littérature jeunesse à la suite du succès d’Harry Potter ou la littérature young adulte) attestent de son renouveau et de sa vigueur.
Ce pourrait être l’objet d’une prochaine chronique…

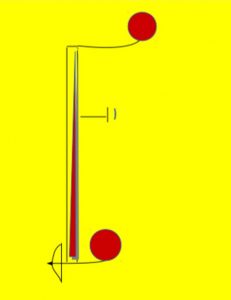
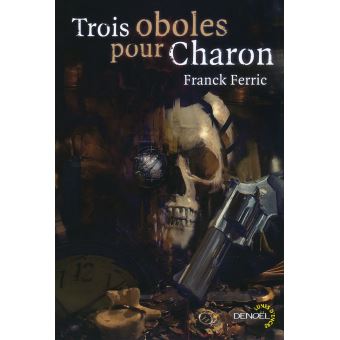
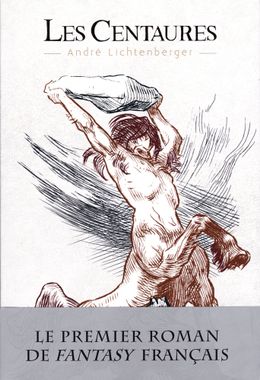
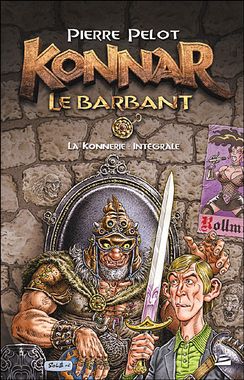

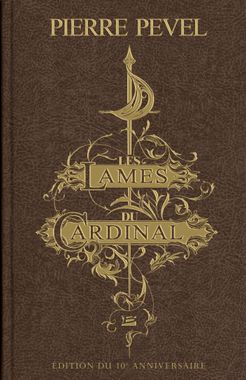 ou Vestiges d’Arcadia de Fabrice Colin, dont l’histoire se situe à Londres au XIXème siècle ou encore Gagner la guerre, de Jean-Philippe Jaworski, dont le cœur de l’intrigue se trouve à Ciudalia (ville imaginaire qui serait le pendant de Florence dans l’Italie de la Renaissance), lieu de pouvoir et capitale de la République.
ou Vestiges d’Arcadia de Fabrice Colin, dont l’histoire se situe à Londres au XIXème siècle ou encore Gagner la guerre, de Jean-Philippe Jaworski, dont le cœur de l’intrigue se trouve à Ciudalia (ville imaginaire qui serait le pendant de Florence dans l’Italie de la Renaissance), lieu de pouvoir et capitale de la République. 
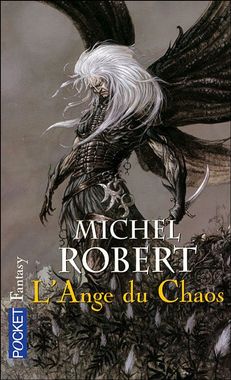

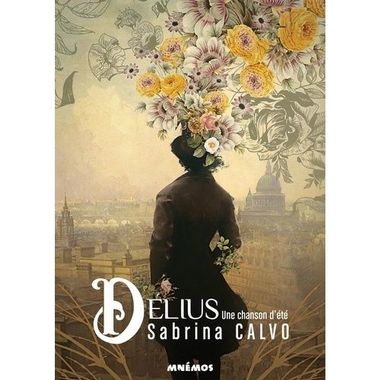
 roman qui se caractérise par le questionnement identitaire d’un écrivain dandy, libertin et désabusé, Jaël de Kherdan. La singularité du roman tient à la structure du récit, étirée et éclatée par la mise en abyme de l’écriture : Jaël met en scène son personnage d’écrivain, enchâssant un récit dans le récit.
roman qui se caractérise par le questionnement identitaire d’un écrivain dandy, libertin et désabusé, Jaël de Kherdan. La singularité du roman tient à la structure du récit, étirée et éclatée par la mise en abyme de l’écriture : Jaël met en scène son personnage d’écrivain, enchâssant un récit dans le récit.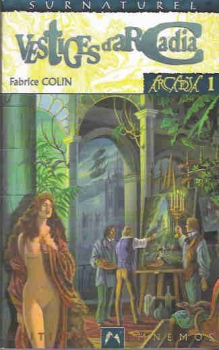
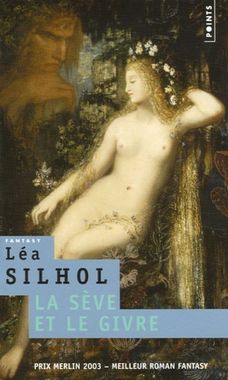 Il s’agit sans doute de l’œuvre de fantasy la plus poétique (et la plus belle d’un point de vue de la langue) qu’il m’ait été donné de lire. À chaque phrase, la poésie éclate et magnifie le récit – inspiré ici de la mythologie irlandaise.
Il s’agit sans doute de l’œuvre de fantasy la plus poétique (et la plus belle d’un point de vue de la langue) qu’il m’ait été donné de lire. À chaque phrase, la poésie éclate et magnifie le récit – inspiré ici de la mythologie irlandaise.



